La diversité des usages de l'eau (production et distribution d'eau potable, traitement des eaux usées, protection des milieux naturels, agriculture, loisirs, industrie...) nécessite la mobilisation et l'intervention d'acteurs multiples et variés (pouvoirs publics, collectivités et élus locaux, acteurs économiques et associations).
Ces différents acteurs ont des compétences bien définies, et leurs responsabilités s'exercent à des échelles géographiques différentes : Europe, France (hexagone et outre-mers), bassins hydrographiques, régions, départements, communes et intercommunalités.
La Martinique est située dans l'une des parties du monde la mieux pourvue en eau, toutefois, les décideurs sont confrontés à la nécessité d'une gestion extrêmement rigoureuse de la ressource. En effet, le contexte insulaire tropical, la topographie du territoire, la forte densité de la population et les données économiques, sociales et environnementales sont autant de contraintes qui obligent l'ensemble des acteurs et la population à une réflexion globale et à la mutualisation des efforts pour une gestion intégrée et durable.

Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) de la Martinique est une instance de gouvernance regroupant les différents acteurs publics ou privés agissant dans le domaine de l’eau du bassin martiniquais. Il est consulté sur toutes les grandes questions se rapportant à la gestion de l’eau en Martinique.
Le Conseil Maritime Ultramarin du bassin des Antilles (CMUBA) est une instance de gouvernance concertée qui a pour principale vocation d'élaborer une politique intégrée de la mer et du littoral, à l'échelle de la zone géographique comprenant les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
La CTM apporte son appui technique et financier aux communes pour les installations de production et de distribution d’eau potable. Elle participe aussi aux actions du SDAGE, et assure un service de prélèvement, de stockage à des fins d’irrigation (barrage de la Manzo…), de distribution, d’entretien des réseaux d’eau, de mise en place de périmètres de protection des captages et de suivi de la ressource. La CTM est aussi gestionnaire d’eau potable (prise d'eau en rivière de Vivé-Capot par exemple).
Elles sont en charge de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales (GEPU), de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).
La Martinique compte 3 communautés :
Ils exploitent et entretiennent les usines et réseaux pour le compte des autorités organisatrices des services d'eau potable et d'assainissement. Ils gèrent également la facturation du service et les relations avec les abonnés. Leurs modalités d'action et leur rémunération sont fixées contractuellement, soit par un contrat de délégation de service public dans le cas d'une exploitation privée, soit par un contrat d'objectifs dans le cas d'une exploitation publique.
L'ODE est l'établissement public dont la mission est de faciliter les politiques publiques :
Elle organise le contrôle sanitaire, mais aussi :
Elles prennent part aux débats sur l'environnement dans le cadre des instances consultatives locales (cliquez ici pour voir la liste des associations agréées et/ou habilitées).
La politique de l'eau se trouve ainsi à l'interface de nombreuses politiques publiques et implique la participation des acteurs à diverses instances de coordination de l'action publique, afin d'élaborer des outils de planification, et permettre leur mise en œuvre.
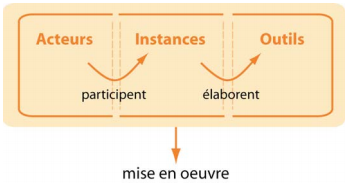
Exemple : les élus qui constituent le Parlement de l'eau, participent au Comité de l'Eau et de la Biodiversité (CEB), afin d'élaborer l'outil de planification qu'est le SDAGE (Schéma Directeur de Gestion et d'Aménagement des eaux). Les orientations fondamentales de la gestion équilibrée des ressources en eau fixées par le SDAGE sont ensuite mises en œuvre, en autre, dans le Programme Pluriannuel d'Intervention (PPI) de l'ODE.
Retrouvez de nombreuses précisions sur les missions des acteurs du rés'Eau, ainsi que leurs coordonnées, dans l'annuaire des acteurs présent sur le site de l'Observatoire, ou directement sur leur site.
Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) de la Martinique est une instance de gouvernance regroupant les différents acteurs publics ou privés agissant dans le domaine de l’eau du bassin martiniquais. Il est consulté sur toutes les grandes questions se rapportant à la gestion de l’eau en Martinique.
Le Conseil Maritime Ultramarin du bassin des Antilles (CMUBA), est une instance de gouvernance concertée qui a pour principale vocation d'élaborer une politique intégrée de la mer et du littoral, à l'échelle de la zone géographique comprenant les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélemy.
La réforme de l'Administration Territoriale de l'Etat, engagée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), est effective en Martinique depuis le 1er janvier 2011.
La Direction de la Mer Martinique est un service déconcentré de l'État français chargé d'appliquer les politiques publiques dans le domaine de la mer. Créée par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, elle est placée sous l'autorité du Préfet de région.
La Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Martinique intervient sur l’ensemble des champs de l’aménagement du territoire et est chargée de mettre en œuvre les politiques du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer ainsi que celles du ministère du logement et de l’habitat durable.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public français de la recherche scientifique. Il est un acteur fondamental de la recherche à l'échelle internationale et touche à tous les domaines scientifiques.
La Safer Martinique (Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) est un acteur clé du développement rural et agricole sur l'île de la Martinique.
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie est un établissement public, placé sous la tutelle des Ministères chargés de la Recherche et de l'Innovation, de la Transition écologique et solidaire, de l'Enseignement supérieur.
L'agence des 50 pas géométriques est un établissement public d'État chargé de la mise en valeur des espaces urbanisés de la zone des 50 pas géométriques, soit une zone littorale de 81,20 mètres calculés à partir de la ligne des plus hautes marées.
L’Office national des forêts (ONF) a pour principales missions la gestion des forêts domaniales et des forêts publiques relevant du Régime forestier ainsi que la réalisation de missions d'intérêt général confiées par l'État.
Créé en 1975, le Conservatoire du Littoral est un établissement public national chargé de mener une politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres... Ces ensembles naturels sont ainsi préservés de toute urbanisation et deviennent un lieu accessible à tous et pour toujours...
L'Agence Régionale de Santé est un établissement public qui a pour mission de mettre en place la politique de santé publique dans la région. Elle a remplacé la DSDS (Direction de la santé et du développement social).
Créé en 1959, le Bureau de recherches géologiques et minières est un établissement public à caractère industriel et commercial dont le statut a été redéfini en 2004.
L'Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture et de l'alimentation.
L’Office de l’Eau (ODE) Martinique est un établissement public territorial créé en 2002, chargé de faciliter diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.
Le Laboratoire Territorial d’Analyses de Martinique (LTA 972) réalise des analyses bactériologiques et physico-chimiques sur les eaux (eaux de consommation, eaux de baignades en mer et en rivière, eaux usées...).
Météo-France est le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France. À ce titre, il exerce les attributions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
Mise en place en décembre 2015, suite au référendum du 24 janvier 2010, la Collectivité Territoriale de Martinique remplace les anciens Conseil Régional et Conseil Général de la Martinique.
La Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique regroupe les 18 communes suivantes : Bellefontaine, Le Carbet, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Saint-Pierre, L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Grand'Rivière, Gros-Morne, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Sainte-Marie, Le Robert et La Trinité.
La Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) regroupe les 4 communes de Fort-de-France, du Lamentin, de Saint-Joseph et de Schœlcher.
La Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud (CAESM) regroupe les 12 communes des Anses-d'Arlet, du Diamant, de Ducos, du François, du Marin, de Rivière-Pilote, de Rivière-Salée, du Saint-Esprit, de Sainte-Anne, de Sainte-Luce, des Trois-Îlets et du Vauclin.
Le laboratoire de Biologie des Organismes et des Écosystèmes marins (BOREA) est une unité de recherche dont les travaux portent sur l'écologie et la biologie des organismes et des habitats aquatiques dans des écosystèmes naturels ou contraints.
Le GREPHY, ou Groupe régional phytosanitaire, est le groupe de travail chargé du suivi des pollutions par les produits phytosanitaires pour la Martinique, comme dans chaque région française.
La présence de l’IRD en Martinique est effective depuis 1951. En 2016 l’ensemble des équipes a rejoint le Campus Agro-environnemental Caraïbe (CAEC) régi par le CIRAD. Depuis 2018 la représentation de l’IRD est assurée par la correspondante Cirad en Martinique.
Le CIRAD (centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement) est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes.
Le CAEC (Campus Agro-Environnemental Caraïbe) est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) intervenant dans le domaine de la recherche et du développement agricole en Martinique. Il remplace le PRAM (Pôle de Recherche Agro-environnementale de la Martinique)
La Délégation Ifremer des Antilles est l’une des six représentations de l’Ifremer présentes dans l’espace ultramarin français. Son domaine géographique de compétences correspond à la ZEE des Antilles françaises, comprenant la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances (La Désirade, Les Saintes et Marie Galante), Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Le Pôle-Relais Zones Humides Tropicales est un des 5 pôles relais œuvrant sur les différents types de milieux humides à l'échelle nationale (zones humides tropicales, tourbières, marais atlantiques, vallées alluviales et lagunes méditerranéennes.
La Caribean Cetacean Society (CCS) est une association martiniquaise et guadeloupéenne créée en 2020. Elle travaille à l'échelle de totue la Caraïbe pour améliorer les connaissance et la conservation des cétécés à travers une coopération internationale.
Créée en Janvier 2023, l'association SOLDA LANMÈ vise à sensibiliser le plus grand nombre à la découverte et à la préservation du patrimoine marin caribéen.
Mon École, Ma Baleine (MEMB) est une association créée en Guadeloupe en 2011 avec deux illustres parrains : Albert Falco et Michel Météry, deux anciens compagnons du commandant Cousteau. Elle possède une antenne en Martinique.
Le but de l'association Zéro Déchet Martinique est de sensibiliser la population martiniquaise à la problématique des déchets, et de proposer des solutions locales et durables pour moins produire de déchets.
Caraïbe Surf Project est un centre éco-sportif qui propose des activités et des initiations aux sports nautiques, tels que le surf et le paddle, en intégrant une dimension éco-pédagogique. L'association, engagée pour la protection de l'environnement, organise avec ses éco-ambassadeurs et partenaires locaux des modules de sensibilisation. Ces modules sont centrés sur la connaissance et la préservation du littoral et des écosystèmes marins.
COCO AN DLO, est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, fondée en 2019 par Dalila ESSEDIRI et Coralie BALMY.
KARISKO est une association dont l'objectif est de promouvoir l'histoire et la culture caribéennes à travers diverses activités culturelles et ludiques, tout en mettant en valeur la nature et les traditions locales.
Entreprises & Environnement œuvre à sensibiliser les Martiniquais à la protection de l’environnement, qui doit être l’affaire de tous. C'est une association à but non lucratif déclarée, agréée et reconnue d’intérêt général dont les membres sont des entreprises martiniquaises. Elle a été créée en mai 1994. Elle rassemble aujourd’hui près de 80 entreprises qui mènent en son sein des actions concrètes en faveur de l’environnement et du patrimoine martiniquais.
L'association H2Eaux propose des activités sportives, aquatiques, nautiques et de pleine nature, favorisant l'épanouissement et le développement personnel.
Le Comité de la Randonnée Pédestre de la Martinique à pour mission de développer la randonnée pédestre en Martinique tant pour sa Pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l'environnement, le tourisme et les loisirs.
L'association Exocet est un club de nage avec palmes pour adultes. Elle participe à des actions de sensibilisation autour du milieu marin.
Roots of the Sea – Rasin Lanmè est une Organisation Non Gouvernementale (association loi 1901, reconnue d’intérêt général) créée en juillet 2020. Elle est animée par de jeunes martiniquais passionnés par leur environnement et plus particulièrement par le milieu marin. Conscients de l’urgence de protection des écosystèmes marins et côtiers, ils propagent ensemble la nécessité d’un engagement durable et local.
PUMA est une association intervenant dans les domaines de la santé, de l'économie et de la protection de l'environnement.
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Martinique (C.R.P.M.E.M MARTINIQUE) est une organisation professionnelle créée le 26 mai 1995, qui réunit l'ensemble des professionnels des pêches maritimes et des élevages marins de la Martinique.
La FDAAPPMA (Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des milieux aquatiques de la Martinique) a piloté le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP).
L'ASSAUPAMAR est une association agréée de protection de l'environnement, fondée le 19 Janvier 1981.
Cette association a pour objet la connaissance du patrimoine marin de la Martinique et de la Caraïbe et la valorisation de cette connaissance auprès du plus grand nombre pour la protection de la mer.
Le Carbet des sciences est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). Créés à l’initiative du Ministère de la Recherche, les CCSTI ont pour but de favoriser un partage des savoirs en offrant au plus large public les moyens de s’informer et de réfléchir sur les évolutions scientifiques et techniques actuelles.
La SME (Société Martiniquaise des Eaux) a été créée en 1977. Elle intervient dans les domaines de la production et de la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des eaux résiduaires, l’expertise et le conseil aux maîtres d’ouvrages dans ses domaines de compétences.
La SAUR (Société d'Aménagement Urbain et Rural) est une société proposant des services de la gestion de l'eau.
ODYSSI est la régie communautaire de la Communauté d´Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)en charge de la gestion et de l'exploitation des services publics d'eau potable et d'assainissement pour les communes de Fort-de-France, Lamentin, Schoelcher et Saint-Joseph.
Le cycle de gestion de l’eau défini par la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE) de 2000 contient la réalisation d’un état des lieux EDL (article R212-3 du code de l'environnement). Le cycle de la gestion de l’eau est un cycle de 6 ans et se schématise ainsi :
L’état des lieux constitue la première étape de la préparation du plan de gestion de district hydrographique demandé par la directive cadre sur l’eau (DCE). Il consiste en une description et un examen de la situation dans le bassin hydrographique et permet ainsi d’identifier les problématiques à traiter. L’état des lieux est adopté par le CEB (Comité de l’Eau et de la Biodiversité). Sa révision est réalisée à chaque cycle de gestion du SDAGE sous la responsabilité du secrétariat du CEB. Selon le Schéma national des données sur l'eau révisé et arrêté le 27 mai 2021, le portage de ce chantier revient à l’ODE. Il s’agit d’une action est réglementaire.
L’état des lieux du district hydrographique de la Martinique réalisé en 2019 doit faire l'objet d'une mise à jour pour être rapporté à l’Union européenne en 2025.
L'objectif est de réaliser l’étude globale de la qualité des milieux aquatiques martiniquais, l’analyse des pressions & impacts et l’étude économique pour le cycle de gestion 2022-2027 selon le guide national (parution fin juin 2023).
Le détail du contenu de l’étude est indiqué dans la note technique.
L’état des lieux contient :
Il inclut également l'inventaire des émissions, des rejets et des pertes des polluants à l'échelle du district hydrographique, en application de la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008.
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des documents relatifs à l'état des lieux précédent réalisé en 2019.
 Retrouvez l'ensemble des documents en lien avec l'EDL 2019 en cliquant ici.
Retrouvez l'ensemble des documents en lien avec l'EDL 2019 en cliquant ici.
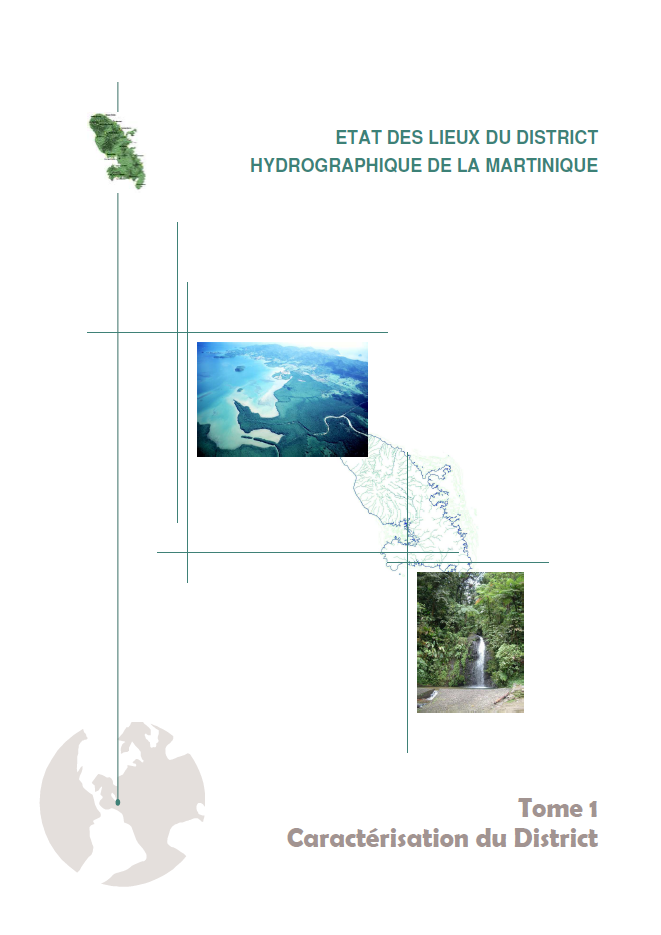
La consultation du public et des acteurs de l'eau sur la révision du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Martinique 2022-2027, menée par le Comité de l'Eau et de la Biodiversité (CEB) de Martinique, s'est déroulée du 2 novembre 2018 au 02 mai 2019.
La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, met en place un cadre communautaire cohérent pour la gestion de l’eau, la préservation et la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
La DCE impose la mise en place de programmes de surveillance des milieux aquatiques pour chaque bassin hydrographique de l'Union européenne.
Adoptée le 23 octobre 2007 par le Parlement européen, la directive inondation a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), est le principal outil de la mise en œuvre de la politique française dans le domaine de l'eau et fait office de plan de gestion préconisé par l’Europe.
La Martinique est soumise sur son territoire à différents aléas. Suivant le territoire concerné, les risques en lien avec l'eau peuvent provenir de phénomènes :
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est un document réalisé par l’État qui réglemente l'utilisation des sols à l'échelle communale, en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Il permet de prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement, de maîtriser l’urbanisation du territoire en évitant d’augmenter les enjeux dans les zones à haut risque et en diminuant la vulnérabilité de l’existant. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.
Retrouvez toutes les informations sur le plan de prévention des risques de la Martinique ci-dessous :
Établi par la circulaire interministérielle de 2016 relative à la mise en œuvre du plan d'actions pour les services d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le Plan Eau DOM vise à agir de façon spécifique dans les départements ultramarins, pour y améliorer les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement sur une période de 10 ans.
La Martinique est soumise sur son territoire à différents aléas, dont certains en relation directe avec l'eau.
Selon les statistiques, on dénombre un phénomène cyclonique (tempête tropicale ou ouragan) tous les 3,6 ans, et un ouragan tous les 11,5 ans.
Le BRGM a publié un atlas des risques naturels qui a permis une prise de conscience du grand nombre de personnes et de biens concernés en cas de catastrophe naturelle en Martinique
Suivant le territoire concerné, les risques en lien avec l'eau peuvent provenir de phénomènes:
Ces mouvements de terrain sont recensés au niveau national dans la base de données BDMVT, gérée et développée depuis 1984 par le BRGM. Vous pouvez consulter la page concernant la Martinique en suivant ce lien.
La pollution par la chlordécone, pesticide utilisé en Martinique en Guadeloupe de 1972 à 1993 pour lutter contre le charançon du bananier, constitue, par son ampleur et sa persistance dans le temps, un enjeu sanitaire, environnemental, agricole, économique et social pour les Antilles.
En 2008, suite aux rencontres politiques du Grenelle de l'Environnement, le premier plan Ecophyto (appelé Ecophyto I ou Ecophyto 2018) a été mis en place par le ministère de l'Agriculture. Ayant pour objectif de réduire l'usage des produits phytosanitaires par 2 avant 2018, ce plan a par la suite été révisé par les plans Ecophyto II (publié en 2015), Ecophyto II+ (publié en 2018) puis la stratégie Ecophyto 2030 (publiée en 2024). Ces plans ont permis la révision successive des objectifs et indicateurs portant sur l'usage des produits phytosanitaires, mais ils ont aussi permis une meilleure intégration des contextes économique et réglementaire dans ces objectifs.
Le contrat Littoral Sud de la Martinique, porté par la CAESM (Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique), a été signé le 11 juillet 2019 par les membres du Comité Littoral Sud regroupant une quarantaine d'acteurs publics et privés.
Le contrat de rivière du Galion, porté par la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique (CAPNM) a été signé le 15 décembre 2016 pour une durée de 5 ans de 2017 à 2021. Le contrat a terminé son cycle de vie et est en phase de renouvelement.
Le contrat de la Grande Baie est un dispositif contractuel d’une durée de 5 ans (actuellement 2021-2026) issu d’une démarche volontaire et partenariale.
Pour appréhender au mieux les adaptations aux changements climatiques à mettre en place dans le domaine de l’eau, l’ODE a réalisé un état des risques sur les cours d’eau de Martinique. La production de cartes de vulnérabilité des rivières au changement climatique et l’élaboration d’un premier plan concret d’adaptation au regard des enjeux de la ressource en eau, de la qualité de l’eau et de la biodiversité des rivières, est une première étape.
Un contrat de milieu est un outil de gestion locale de l'eau, à l’échelle d'un bassin versant.
Il fixe pour la rivière, la baie ou le littoral des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs en 5 ans.
Les objectifs de ce type de contrat n’ont pas de portée juridique. Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : Préfet , Office de l’Eau, collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...), et les acteurs du territoire concerné (industriels, associations de consommateurs,...).
L’intérêt de cette démarche « contractuelle » est de prendre en compte les problématiques majeures liées à l’eau sur un territoire pertinent et cohérent (une rivière ou une baie et son bassin versant) en impliquant l’ensemble des acteurs et des usagers de ce territoire.
Pour aller plus loin sur les contrats de milieu : http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/contrat
3 contrats de milieu sont en cours d'exécution :
le contrat de la Grande Baie, porté par la CACEM (Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique) ;
le contrat de rivière du bassin versant du Galion, porté par CAP Nord (Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique) ;
le contrat de littoral Sud, porté par la CAESM (Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud de la Martinique).
1 contrat est en cours d'élaboration : le contrat littoral Nord, porté par la CAPNM (Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique).